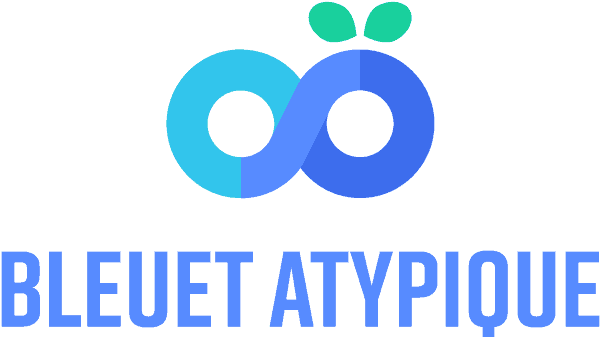J’ai appris que pour s’échapper d’un remous, il fallait se laisser couler jusqu’au fond pour ensuite avoir la possibilité de donner un grand coup de pied afin de s’échapper par le côté.
La semaine dernière, une personne de ma famille m’a téléphoné et la conversation m’a avalée. Un grand écran « danger » s’est mis à clignoter dans ma tête, mais il était trop tard. Lorsque j’ai réalisé que j’avais été aspirée par le tourbillon je n’ai eu d’autre choix que de me laisser entrainer. Au ralenti, avec un silence pour m’accompagner, je me suis regardé descendre jusqu’au fond. Et pour me défendre, j’ai donné ce violent coup de pied, cette phrase qui pour moi était méchante. C’était ma petite violence à moi, la seule dont je suis capable. J’ai simplement dit : « Tu ne me croiras pas, mais les gens m’aiment. » Comment est-ce que j’en suis venu à ressentir le besoin de justifier le simple fait que mon entourage m’apprécie ? Ça m’a tracassé toute la semaine… Pourquoi ai-je tant eu besoin de lancer cette phrase affront qui me ferait mal autant qu’à elle ? Pour me rassurer, me conforter dans mon idée ou pour être bien certaine que cette vision ne m’échapperait pas ?
Le sujet, aujourd’hui, c’est : Comment ça se fait que tout monde détestait l’enfant autiste et comment ça a teinté mes perceptions.
J’ai compris très rapidement toute petite que je tombais sur les nerfs des gens et on avait de cesse de me le rappeler. Toujours. Partout. La chose nuisible et désagréable c’était moi. Il parait que je suis née sans le modulateur sonore puisque « ma petite voix fatigante » comme on la décrivait était selon ce qu’on me disait insupportable. Ça commençait mal. J’avais un son de crécelle agonisante.
À la prématernelle déjà la dame était irritée lorsqu’il m’était essentiel et vital de faire respecter un rythme parfait dans la disposition des coussins jaunes et bleus. Je ne comprenais pas sa réaction puisque je me proposais de moi-même tout organiser adéquatement afin de me permettre de respirer plus doucement sans avoir à supporter cette anarchie visuelle. Lors des bricolages, lorsqu’il fallait « faire comme », je lui donnais des ulcères. Non, je ne peux pas faire comme si ce monsieur dans le catalogue est mon papa, ce n’est pas lui. Fait comme si ! Non, ce n’est pas lui. Et je cherchais frénétiquement à travers les autres piles l’image désirée sans la dénicher. Elle fulminait, frustrée devant ma rigidité. Lorsque nous nous sommes déguisés en robots et que nous devions nous ébattre dans une salle habituellement réservée aux assemblées de la ville je ne voulais pas courir avec les autres et je réclamais le silence puisque je savais que ce local était habituellement dédié à l’écoute. Je revendiquais le respect du lieu et elle me regardait avec dédain en se demandant ce que je pouvais bien lui vouloir avec mes élucubrations. Lorsqu’on revenait me chercher à la fin de la journée, elle se plaignait de mon manque de coopération, du fait que je ne voulais pas jouer avec les autres enfants et participer. Ce sera une rebelle cette enfant ! Et je devais être cassée rapidement sans quoi…
Des fois, ces rares fois avec un espoir d’être aimée comme j’étais.
Un jour, un homme a ri parce qu’en apercevant une cabane à oiseaux avec de multiples trous j’ai dit : « Ha ! Un bloc d’appartements pour les oiseaux. » Cet homme m’a trouvé drôle et il l’a mentionné. Je fus tellement surprise et interloquée qu’à chaque fois que j’apercevais cet homme j’espérais de tout mon cœur qu’il me trouve encore rigolote, mais le mutisme m’envahissait dès que je le voyais. Trop d’espérance. Je me suis accrochée pendant des années à ce commentaire, ce petit compliment, comme si c’était mon seul espoir. Mais il ne m’a plus reparlé par la suite.
Anarchiques petits humains avec qui je n’ai rien en commun.
L’entrée à la maternelle fut un véritable désastre. Tout autour me semblait insensé, illogique, idiot et sans but. Le professeur qui tentait de nous faire rire en tirant une souris en plastique avec une ficelle en faisant comme si c’était une vraie. Les autres qui trouvaient ça drôle et moi qui ne comprenais absolument pas ce qui était censé être comique. Je savais déjà lire et écrire depuis longtemps et tout ceci m’apparaissait vide de sens. Pourtant je ne savais que pleurer pour exprimer mon désarroi. En plus, j’étais laide comme un insecte écrasé.
Lorsque l’autobus m’a ramené à la maison à la fin du jour un, j’ai profité d’un moment d’inattention du chauffeur pour me sauver en courant. Vous auriez dû le voir me poursuivre en m’implorant de remonter. C’est avec ce profil bizarre et particulier que j’ai attaqué mon primaire. J’ai à peine eu le temps de comprendre ce qui m’arrivait que le professeur me détestait ainsi qu’une bonne majorité des élèves. Mes seules activités étaient la lecture et le dessin, je lisais partout, tout le temps, en marchant, durant les cours, la nuit, en permanence. Et je tentais d’ignorer tout le reste autour. Aucun humour, aucune tolérance, aucun intérêt envers leurs jeux bizarres et aucune habileté sportive, mon sort était scellé.
Quand petits méchants deviennent grand méchants.
Ça a commencé avec des jambettes, dès que je passais on allongeait la jambe pour me voir tomber en pleine face, ensuite les coups, les tapes derrière la tête très fort dès que j’étais dans ma bulle, c’est à dire tout le temps. On remplissait mon manteau de neige lors des grands froids, on me lançait des roches. On me crachait dessus pratiquement chaque jour. J’étais devenu le jouet qui ne se défendait pas. L’affaire bizarre qui ne réagissait pas. Pleurer, c’est tout ce que je savais faire. Un jour, on m’a lancé en bas d’un module en éducation physique et je me suis fracassé la tête contre le ciment. Et plus les petits tortionnaires grandissaient plus les jeux étaient cruels, ça a dégénéré à en devenir franchement dangereux. Le sac en plastique sur la tête pour m’empêcher de respirer, le bris de mes lunettes, on ne me laissait aucun répit. Sans compter les insultes qui rivalisaient par leur sadisme. J’ai passé un hiver complet mon corps serré contre la poubelle, la tête et les bras entrés dans mon manteau avec rien qui dépasse, parce que la zone des déchets était la moins achalandée.
Je vivais dans un monde parallèle dans ma tête et je n’avais pas du tout l’impression d’habiter mon enveloppe physique, il m’était donc plus facile d’errer détachée de tout que de participer à ce théâtre malsain. Encore aujourd’hui je remercie cette facilité que j’ai à sortir de moi pour me réfugier je ne sais où même si ce réflexe me donne parfois un air perdu.
Il y avait les autres, et il y avait moi. Deux mondes sans liens. Mon identité complète a commencé à se forger autour de cette situation. J’étais celle qu’on battait. Je n’avais rien que j’aimais de ma personne à quoi me raccrocher, j’ai donc commencé à réfléchir en victime assumée. C’était désormais mon rôle. Je le méritais, je ne valais rien. Le plus malsain c’est que j’en suis venue à attendre les coups et parfois même les espérer. Comme c’était tout ce qui me définissait, leur absence me laissait vide, bizarre, sans but. Et plus le temps passait plus ma haine envers moi grandissait. Comment est-il possible de se détester à ce point pour une enfant ?
Même mon apparence ne jouait pas en ma faveur, je ne comprenais pas qu’il fallait laver les cheveux dès la racine et je m’évertuais donc à frotter la chevelure très fort, mais sans jamais promener mes doigts sur le cuir chevelu, j’avais ainsi les cheveux gras et je n’arrivais pas à me coiffer correctement. Mes vêtements n’avaient rien en commun avec ceux des autres et je marchais le dos penché en regardant vers le sol, raide comme un robot, comme si j’avais une seule articulation géante et sans trop savoir quoi faire de mes bras.
J’ai aussi passé une année entière à chanter bien fort la liste des choses que je n’avais pas le droit de dire. J’en avais fait une comptine réunissant tout ce qu’on considérait comme impoli ou inadéquat et je le répétais à longueur de journée. Je peux encore le réciter. Et les tocs, les innombrables tocs… Par exemple, je comptais tout, mais je ne savais pas encore le cacher. Mes pas devaient former des équations, ainsi que les objets devant moi, les sensations sur mon corps et pas mal tout ce qui m’entourait, et c’était visible. On m’appelait Parkinson, c’est pour dire. Je sais maintenant le faire avec discrétion, par chance. En permanence, en toute situation, tout le temps j’étais rejetée, détestée et je dérangeais comme le moustique désagréable que vous voudriez éloigner du revers de la main parce qu’il est agaçant.
Je ne comprends pas les gens qui écrivent des lettres de réconfort à leur soi enfant. Personnellement, je le déteste encore, j’en ai honte et je n’ai nullement l’intention de lui pardonner.
Je devais probablement être méchante et dangereuse ?
À la maison, on me croyait manipulatrice et mauvaise, peut-être parce que je n’étais pas affectueuse et ne regardais pas dans les yeux, je ne sais pas, mais comme je vivais tout très intensément, lorsque je tentais de prendre ma place et de dire ce que je vivais on ne me croyait pas. J’étais donc coincée dans un corps qui ne m’écoutait pas et un environnement hostile qui ne m’écoutait pas non plus et tranquillement, insidieusement j’ai développé une haine sans nom envers moi. Chaque morceau de mon corps et de ma personnalité m’était devenu insupportable. J’avais l’estime personnelle d’une moufette écrasée avec son urine comme seule trace de sa fin tragique.
On m’accusait constamment de malice et de mauvaise intention, comme cette fois où durant un événement rempli d’enfants je me suis cachée en surcharge entre le lit et le mur et qu’on a cru à un enlèvement parce que je ne suis jamais sortie de ma cachette, et ce durant des heures. Ce fut le branle-bas de combat, je les entendais, mais j’étais incapable de m’extraire de là. Ou encore lorsque j’ai supposément, par pure mesquinerie abandonné mon frère handicapé. En fait, je tentais de récupérer un ballon pour lui. Non, c’était des excuses bien entendu, si je l’ai laissé seul c’est que je m’en fous (saisir ici la pointe de sarcasme).
Crier.
Paniquée sans cesse, je faisais d’énormes crises en hurlant ma détresse. Et j’ai une voix qui porte. Comme nous vivions dans un jumelé, les voisins se succédaient à une vitesse effarante, inquiets d’entendre ce monstre brailler de la sorte. C’est comme si on m’égorgeait à chaque fois, je hurlais à mort, je me tapais dessus moi-même et je détruisais ma chambre au complet. Tout y passait. Une fois l’environnement bien ravagé et moi vidée de l’énergie dévastatrice, je m’écroulais d’épuisement pour pleurer durant des heures en petite boule dans un coin par terre. Je voulais mourir, et parfois j’essayais.
Ça a duré des années comme ça. Longtemps…. Trop longtemps. Il a fallu que ma vie s’écroule au complet à l’âge adulte pour que je me donne ensuite le droit de me reconstruire, de repartir en neuf, de créer une nouvelle moi qu’on ne détesterait pas. Je suis déménagée loin, à plus de cinq heures de route. Je suis incapable à ce jour de simplement traverser en voiture la ville de mon enfance. Et lorsqu’on me fait un compliment, je suis mal. Ça me donne instantanément envie de pleurer et je m’affaire à donner une raison logique à la mention dans le but de m’enlever le mérite. J’ai toujours ce réflexe de m’insulter moi-même et parfois plus. Ce n’est jamais contre les autres, jamais au grand jamais contre mes enfants ou mon conjoint, c’est tout discret, c’est caché, souvent quand je suis seule et c’est toujours contre moi.
Comprendre. Doucement.
Pour en revenir à l’introduction de ce texte, voilà pourquoi j’ai eu besoin de justifier ma démarche, celle d’avoir le droit de m’entourer de gens qui m’aiment. D’un côté, suite à cette longue explication, j’arrive à comprendre le dédain généralisé que j’inspirais, mais de l’autre j’ai des doutes… Je ne saurai jamais si j’étais vraiment si épouvantablement détestable que ça, parce que ça me surprend quand même qu’on puisse changer à ce point. C’était là, caché en moi ? Une personne douce et gentille sans traces d’agressivité ? Et vraiment, on ne pouvait pas la voir ? C’était si invisible et impossible à déceler que j’étais là quelque part sous cette tonne de négatif ?
J’ai énormément hésité avant d’écrire ce texte. Jamais je n’ai pris autant de temps et changé autant de fois d’idée. Mais j’ai cette petite voix qui me dit que ça peut servir à des parents surpassés par la situation qui ont l’impression d’avoir accouché d’une bête hirsute et enragée. Sans doute que si on n’avait pas voulu à tout prix me briser pour que je sois le petit robot qui fait comme tout le monde, on aurait eu accès bien plus rapidement à ce qu’il y a en dessous. J’ai de sérieux doutes sur l’étiquette du petit avec lequel il n’y a rien à faire. Ça peut valoir la peine d’essayer de voir ce qui se cache sous la chrysalide sans tenter de tout arracher violemment pour la former à notre image. Sinon ça laisse des traces. Je crois que je n’arriverai jamais à les effacer.
Je m’affaire à m’assurer hors de tout doute que chaque parcelle de personnalité de mes enfants trouve sa place et j’ai une peur bleue de briser quelque chose. Toujours, je garde en tête qu’il ne faut pas enfouir leur moi profond sous une carapace qui ne leur appartient pas. Le bonheur ne peut pas être mimé, il doit être ressenti.